Charif Majdalani : Tous mes livres parlent des transformations qui aboutissent à l’effondrement des sociétés...

Propos recueillis par Zéna Zalzal in l'Orient - Le Jour
À travers une intrigue tout en suspense se déroulant en Irak à la veille des invasions de l’État islamique, le romancier libanais d’expression française partage, dans « Dernière oasis », qui vient de sortir aux éditions Actes Sud-L’Orient des livres, ses questionnements sur l’intentionnalité des événements qui façonnent la marche, erratique, du monde.
Sélectionné sur les deux premières listes du jury du Femina de cette rentrée – qui lui avait par ailleurs accordé, l’an dernier, un Prix spécial pour son récit Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement (Seuil) –, Dernière oasis de Charif Majdalani (Actes Sud-L’Orient des livres) prouve une fois de plus la présence indéniable de cet écrivain libanais sur la grande scène littéraire francophone.
Dans ce dernier roman, l’auteur de Histoire de la grande maison, de Caravansérail et de L’empereur à pied (pour ne citer que quelques-uns de ses titres, tous édités au Seuil), entame, avec succès, un élargissement du champ de son univers fictionnel jusque-là exclusivement libanais et plutôt passéiste. Car c’est autour des tribulations d’un spécialiste libanais (certes!) de l’archéologie orientale invité en Irak au printemps 2014, à la veille de l’invasion de Mossoul par l’État islamique, par un mystérieux général pour expertiser des frises assyriennes, que Majdalani a construit sa nouvelle fiction. Un suspense géopolitique contemporain, sur fond de pillage de patrimoine artistique en période de guerre – étayé d’une somptueuse description d’un temps contemplatif au sein d’un paysage millénaire –, à travers lequel il livre, aux lecteurs, une réflexion profonde sur le sens (ou l’absence de sens) de l’histoire…
Entretien avec l’auteur, par ailleurs professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Saint-Joseph, sur ce nouveau « roman complet » : tout à la fois prenant, érudit et d’une lecture fluide.

" Tous les personnages qui s’individualisent, qui sortent du cercle étroit de la famille ou de la communauté, qui partent à la rencontre du monde, ou qui ont des rêveries d’actions épiques sont des projections idéales de moi " , affirme Charif Majdalani. Photo DR
Vous avez publié ces deux dernières années deux livres de suite : le récit « Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement » (Seuil) et ce roman « Dernière oasis » (Actes Sud-L’Orient des livres). Contrairement à beaucoup, le confinement vous a été propice…
Le confinement n’y est pour rien. J’ai commencé à écrire ce qui allait devenir Dernière oasis bien avant, et avant même le soulèvement de 2019. J’ai fini de travailler dessus après le premier grand confinement mondial, ce qui explique que je parle de cet événement à la fin du livre. Mais j’ai préféré surseoir à la publication de cet ouvrage pour des raisons diverses et j’ai commencé à écrire le journal qui allait devenir Beyrouth 2020, qui est finalement sorti avant ce roman.
Alors que jusque-là toute votre œuvre romanesque se situait dans le registre des épopées individuelles et des sagas familiales libanaises, partant de la fin de l’Empire ottoman aux années précédant le basculement du Liban dans la guerre civile, vous abordez cette fois de nouveaux espaces temporels et géographiques. Qu’est-ce qui a provoqué ce tournant dans votre univers fictionnel ?
J’ai en effet changé de décor et aussi, bien sûr, de dispositif narratif. Le sujet est également et en apparence très lié aux événements du monde contemporain. Mais en fait, je continue à traiter les mêmes sujets, à partir d’angles différents, en élargissant le champ, ou en modulant les approches. Tous mes livres parlent du temps, de l’histoire, des transformations qui aboutissent à l’effondrement des sociétés, à des basculements d’une époque dans une autre.
Dans mes précédents livres, les histoires de famille étaient des histoires de bouleversements dus à des changements produits par les violences de l’histoire. Laquelle y faisait toujours irruption à un moment donné pour détruire des équilibres, bousculer des univers et des communautés installées sur des terres ou dans des quartiers considérés comme immuables.
Ce qui m’importait donc, c’était ces transformations brutales du monde et des sociétés, et surtout leur effet sur les hommes. Dans Dernière oasis, c’est un peu la même chose, mais de manière autre, certes, ce qui peut donner l’impression qu’il y a changement de cap.
Si j’ai choisi l’Irak du printemps et de l’été 2014, c’est parce que j’avais besoin d’un lieu où soient possibles alternativement des moments de calme absolu puis l’irruption de l’histoire dans ce qu’elle a de plus imprévisible. Irruption qui a fait basculer, non pas une région, mais le monde entier dans le chaos. En août 2014, on s’en souvient, c’est l’humanité tout entière qui a cru être aspirée dans le gouffre de la violence.
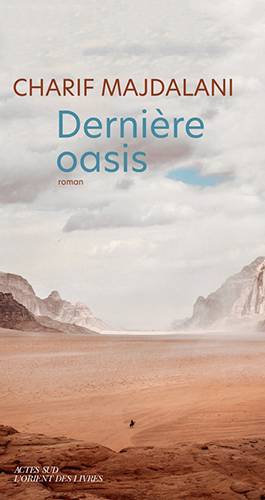
« Dernière oasis » de Charif Majdalani, un roman contemporain qui allie suspense et réflexion.
C’est un roman d’aventures et de méditations. Un récit contemporain, sorte de thriller géopolitique au suspense latent, traversé de longues plages contemplatives. Un texte où la violence du monde actuel, décrite presque sur le mode du reportage, est confrontée à l’immuabilité de la nature immémoriale. Et malgré le fait que l’intrigue se déroule ailleurs, certains passages de ce livre offrent des résonances fortes avec la situation du Liban. N’a-t-il pas été particulièrement difficile d’imbriquer ces différentes facettes dans une même histoire ?
Non, pas du tout. C’est au contraire le plus grand des plaisirs que celui de pouvoir ainsi faire jouer les registres et les plans. Ce que je voulais d’abord décrire, c’était la résidence d’un homme dans un lieu hors du temps, de l’histoire et même de la géographie. C’était l’histoire d’une attente au cœur de l’immuabilité du monde. Mais le but était également de faire aller irrésistiblement les choses vers le désastre – en l’occurrence ici les événements d’août 2014 dans la plaine de Ninive. Or évidemment, tous les désastres guerriers, tous les conflits qui aboutissent à des déplacements de population se ressemblent, comme se ressemblent toutes les tragédies humaines. Cela renvoie donc à ce qui s’est passé au Liban, mais ailleurs aussi dans le monde.
Le titre en lui-même, « Dernière oasis », est ambivalent. On peut l’interpréter comme la métaphore de la destruction inéluctable du monde civilisé, en particulier dans notre région du monde ou, au contraire, comme celle d’un espace où serait préservée, malgré tout, une certaine humanité face à la monstruosité des événements… Laquelle privilégiez-vous ?
Eh bien ! ce sont les deux à la fois. Ces plantations (quand même un peu fatiguées et écrasées de chaleur) sont perçues par le personnage comme un lieu suspendu hors du temps et de l’espace, et les rendent par conséquent édéniques à ses yeux. C’est aussi ce que pense le général Ghadban, qui est persuadé que ce sont là les derniers vestiges du paradis de la Bible, dont on a l’habitude de dire que la description a été influencée par les jardins antiques de cette région. Et ce personnage un peu fou rêve de tout replanter, de faire revivre les jardins originels à la place de ce désert, et donc de ressusciter le paradis. Et dans son discours, le fait que le paradis soit devenu ce bout de plantations minables est, en effet, comme la projection du devenir entier de la planète. Tout le long du livre, le personnage-narrateur parle de l’entropie, du lent désordre qu’introduit l’homme dans le monde et qui s’accentue aujourd’hui. Cette oasis du nord de l’Irak, tout en étant perçue comme un lieu de rêverie idéale, est également ressentie comme la métaphore des effets de l’entropie, des désastres environnementaux, politiques et sociaux provoqués par la mauvaise gouvernance, la violence et l’irresponsabilité des hommes. Ou simplement par l’irréversible devenir du monde.
Vous décrivez merveilleusement bien les paysages du nord de l’Irak où vous situez votre intrigue mais aussi les ambiances, les atmosphères, les faits qui y sont survenus au cours de l’été 2014. Vous êtes-vous rendu sur place, ultérieurement, pour nourrir votre fiction ?
Il était impossible d’y aller au moment où j’écrivais le livre. Je me suis contenté d’une exploration des cartes et des photos, et de Google Earth, qui permet de se rapprocher considérablement des lieux de la terre où l’on ne peut aller physiquement. Après quoi j’ai beaucoup interrogé des réfugiés irakiens au Liban, notamment ceux qui venaient des régions que je décris dans le livre. Ils m’ont permis de ne pas faire d’erreur sur le climat, la végétation, sur tous les détails essentiels pour la vraisemblance d’un récit. Et puis il faut dire que je connais assez bien les régions semi-désertiques de Syrie ou de Jordanie, et donc tout ce qui regarde la lumière, les couleurs avec le passage du jour, les effets de la chaleur...
Le héros de votre roman est un archéologue libanais contemplatif, nostalgique d’une certaine beauté originelle du monde, en quête d’émotions esthétiques et qui s’interroge sans cesse sur le sens de l’histoire… À quel point vous ressemble-t-il ? Serait-il, parmi la galerie de personnages que vous avez créés jusque-là, celui qui vous est le plus proche ?
Ce personnage est évidemment une sorte de projection de moi-même. Tout ce qu’il dit et pense, c’est moi qui le pense et le lui fait dire, sur l’histoire autant que sur l’émotion esthétique ou sur le dévoilement de l’œuvre d’art. Mais il n’est pas nécessairement le plus proche de moi parmi les personnages de l’ensemble de mes livres. Dans ces derniers, tous les personnages qui s’individualisent, qui sortent du cercle étroit de la famille ou de la communauté, qui partent à la rencontre du monde, ou qui ont des rêveries d’actions épiques sont des projections idéales de moi.
Votre narrateur est persuadé que l’histoire se déroule de manière totalement chaotique et qu’elle est souvent le fruit du hasard et des imprévus. Tout son propos va dans le sens de la réfutation des fameuses théories du complot – celle des interventions sous-jacentes des grandes puissances dans tous les événements de la planète – particulièrement prisées par les populations du monde arabe. Où vous situez-vous dans cette façon de penser le monde ?
L’homme n’aime pas le non-sens, ni le fait que l’histoire soit complètement erratique. Il faut que les événements soient lisibles, qu’il y ait un responsable, quelqu’un qui pilote le monde, qui sait où on va et qui nous y conduit. C’est la fonction que l’on attribue traditionnellement à Dieu, et qu’on attribue aujourd’hui, souvent, aux grandes puissances, à l’Amérique, à la Russie ou à la Chine. On peut aussi l’attribuer aux grands mouvements de société, aux forces économiques. Ou alors, dans une perspective paranoïaque, à des complots universels. Or il me semble plutôt que l’histoire et les événements qui se produisent en permanence sont davantage le fruit de planifications ratées, de l’intervention du hasard, de l’imprévu, mais aussi le résultat de l’incompétence ou de l’imprévoyance des hommes qui nous gouvernent, de la bêtise de leurs conseillers et des experts qui les entourent. Si on la regarde avec un peu de recul, on s’aperçoit que l’histoire n’est dotée d’aucune intentionnalité. Ou s’il y a des intentions initiales dans le déclenchement de chaque événement, leur déroulement est très vite dévoyé à cause de décisions prises sur le tas, maladroitement ou par sottise, ou à cause de mille hasards et tout va alors au gré de ce qui advient, que l’homme gère ensuite au mieux – ou le plus souvent au pire.

« Tous les personnages qui s’individualisent, qui sortent du cercle étroit de la famille ou de la communauté, qui partent à la rencontre du monde, ou qui ont des rêveries d’actions épiques sont des projections idéales de moi », affirme Charif Majdalani. Photo DR
Sélectionné sur les deux premières listes du jury du Femina de cette rentrée – qui lui avait par ailleurs accordé, l’an dernier, un Prix spécial pour son récit Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement (Seuil) –, Dernière oasis de Charif Majdalani (Actes Sud-L’Orient des livres) prouve une fois de plus la présence indéniable de cet écrivain libanais sur la grande scène littéraire francophone.
Dans ce dernier roman, l’auteur de Histoire de la grande maison, de Caravansérail et de L’empereur à pied (pour ne citer que quelques-uns de ses titres, tous édités au Seuil), entame, avec succès, un élargissement du champ de son univers fictionnel jusque-là exclusivement libanais et plutôt passéiste. Car c’est autour des tribulations d’un spécialiste libanais (certes!) de l’archéologie orientale invité en Irak au printemps 2014, à la veille de l’invasion de Mossoul par l’État islamique, par un mystérieux général pour expertiser des frises assyriennes, que Majdalani a construit sa nouvelle fiction. Un suspense géopolitique contemporain, sur fond de pillage de patrimoine artistique en période de guerre – étayé d’une somptueuse description d’un temps contemplatif au sein d’un paysage millénaire –, à travers lequel il livre, aux lecteurs, une réflexion profonde sur le sens (ou l’absence de sens) de l’histoire…
Entretien avec l’auteur, par ailleurs professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Saint-Joseph, sur ce nouveau « roman complet » : tout à la fois prenant, érudit et d’une lecture fluide.

« Tous les personnages qui s’individualisent, qui sortent du cercle étroit de la famille ou de la communauté, qui partent à la rencontre du monde, ou qui ont des rêveries d’actions épiques sont des projections idéales de moi », affirme Charif Majdalani. Photo DR
Vous avez publié ces deux dernières années deux livres de suite : le récit « Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement » (Seuil) et ce roman « Dernière oasis » (Actes Sud-L’Orient des livres). Contrairement à beaucoup, le confinement vous a été propice…
Le confinement n’y est pour rien. J’ai commencé à écrire ce qui allait devenir Dernière oasis bien avant, et avant même le soulèvement de 2019. J’ai fini de travailler dessus après le premier grand confinement mondial, ce qui explique que je parle de cet événement à la fin du livre. Mais j’ai préféré surseoir à la publication de cet ouvrage pour des raisons diverses et j’ai commencé à écrire le journal qui allait devenir Beyrouth 2020, qui est finalement sorti avant ce roman.
Alors que jusque-là toute votre œuvre romanesque se situait dans le registre des épopées individuelles et des sagas familiales libanaises, partant de la fin de l’Empire ottoman aux années précédant le basculement du Liban dans la guerre civile, vous abordez cette fois de nouveaux espaces temporels et géographiques. Qu’est-ce qui a provoqué ce tournant dans votre univers fictionnel ?
J’ai en effet changé de décor et aussi, bien sûr, de dispositif narratif. Le sujet est également et en apparence très lié aux événements du monde contemporain. Mais en fait, je continue à traiter les mêmes sujets, à partir d’angles différents, en élargissant le champ, ou en modulant les approches. Tous mes livres parlent du temps, de l’histoire, des transformations qui aboutissent à l’effondrement des sociétés, à des basculements d’une époque dans une autre.
Dans mes précédents livres, les histoires de famille étaient des histoires de bouleversements dus à des changements produits par les violences de l’histoire. Laquelle y faisait toujours irruption à un moment donné pour détruire des équilibres, bousculer des univers et des communautés installées sur des terres ou dans des quartiers considérés comme immuables.
Ce qui m’importait donc, c’était ces transformations brutales du monde et des sociétés, et surtout leur effet sur les hommes. Dans Dernière oasis, c’est un peu la même chose, mais de manière autre, certes, ce qui peut donner l’impression qu’il y a changement de cap.
Si j’ai choisi l’Irak du printemps et de l’été 2014, c’est parce que j’avais besoin d’un lieu où soient possibles alternativement des moments de calme absolu puis l’irruption de l’histoire dans ce qu’elle a de plus imprévisible. Irruption qui a fait basculer, non pas une région, mais le monde entier dans le chaos. En août 2014, on s’en souvient, c’est l’humanité tout entière qui a cru être aspirée dans le gouffre de la violence.
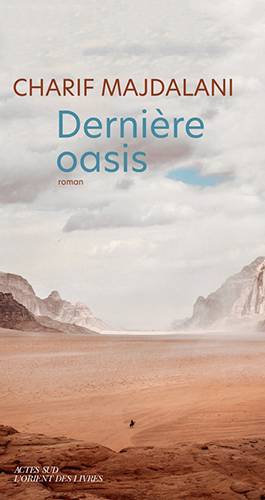
« Dernière oasis » de Charif Majdalani, un roman contemporain qui allie suspense et réflexion.
C’est un roman d’aventures et de méditations. Un récit contemporain, sorte de thriller géopolitique au suspense latent, traversé de longues plages contemplatives. Un texte où la violence du monde actuel, décrite presque sur le mode du reportage, est confrontée à l’immuabilité de la nature immémoriale. Et malgré le fait que l’intrigue se déroule ailleurs, certains passages de ce livre offrent des résonances fortes avec la situation du Liban. N’a-t-il pas été particulièrement difficile d’imbriquer ces différentes facettes dans une même histoire ?
Non, pas du tout. C’est au contraire le plus grand des plaisirs que celui de pouvoir ainsi faire jouer les registres et les plans. Ce que je voulais d’abord décrire, c’était la résidence d’un homme dans un lieu hors du temps, de l’histoire et même de la géographie. C’était l’histoire d’une attente au cœur de l’immuabilité du monde. Mais le but était également de faire aller irrésistiblement les choses vers le désastre – en l’occurrence ici les événements d’août 2014 dans la plaine de Ninive. Or évidemment, tous les désastres guerriers, tous les conflits qui aboutissent à des déplacements de population se ressemblent, comme se ressemblent toutes les tragédies humaines. Cela renvoie donc à ce qui s’est passé au Liban, mais ailleurs aussi dans le monde.
Le titre en lui-même, « Dernière oasis », est ambivalent. On peut l’interpréter comme la métaphore de la destruction inéluctable du monde civilisé, en particulier dans notre région du monde ou, au contraire, comme celle d’un espace où serait préservée, malgré tout, une certaine humanité face à la monstruosité des événements… Laquelle privilégiez-vous ?
Eh bien ! ce sont les deux à la fois. Ces plantations (quand même un peu fatiguées et écrasées de chaleur) sont perçues par le personnage comme un lieu suspendu hors du temps et de l’espace, et les rendent par conséquent édéniques à ses yeux. C’est aussi ce que pense le général Ghadban, qui est persuadé que ce sont là les derniers vestiges du paradis de la Bible, dont on a l’habitude de dire que la description a été influencée par les jardins antiques de cette région. Et ce personnage un peu fou rêve de tout replanter, de faire revivre les jardins originels à la place de ce désert, et donc de ressusciter le paradis. Et dans son discours, le fait que le paradis soit devenu ce bout de plantations minables est, en effet, comme la projection du devenir entier de la planète. Tout le long du livre, le personnage-narrateur parle de l’entropie, du lent désordre qu’introduit l’homme dans le monde et qui s’accentue aujourd’hui. Cette oasis du nord de l’Irak, tout en étant perçue comme un lieu de rêverie idéale, est également ressentie comme la métaphore des effets de l’entropie, des désastres environnementaux, politiques et sociaux provoqués par la mauvaise gouvernance, la violence et l’irresponsabilité des hommes. Ou simplement par l’irréversible devenir du monde.
Vous décrivez merveilleusement bien les paysages du nord de l’Irak où vous situez votre intrigue mais aussi les ambiances, les atmosphères, les faits qui y sont survenus au cours de l’été 2014. Vous êtes-vous rendu sur place, ultérieurement, pour nourrir votre fiction ?
Il était impossible d’y aller au moment où j’écrivais le livre. Je me suis contenté d’une exploration des cartes et des photos, et de Google Earth, qui permet de se rapprocher considérablement des lieux de la terre où l’on ne peut aller physiquement. Après quoi j’ai beaucoup interrogé des réfugiés irakiens au Liban, notamment ceux qui venaient des régions que je décris dans le livre. Ils m’ont permis de ne pas faire d’erreur sur le climat, la végétation, sur tous les détails essentiels pour la vraisemblance d’un récit. Et puis il faut dire que je connais assez bien les régions semi-désertiques de Syrie ou de Jordanie, et donc tout ce qui regarde la lumière, les couleurs avec le passage du jour, les effets de la chaleur...
Le héros de votre roman est un archéologue libanais contemplatif, nostalgique d’une certaine beauté originelle du monde, en quête d’émotions esthétiques et qui s’interroge sans cesse sur le sens de l’histoire… À quel point vous ressemble-t-il ? Serait-il, parmi la galerie de personnages que vous avez créés jusque-là, celui qui vous est le plus proche ?
Ce personnage est évidemment une sorte de projection de moi-même. Tout ce qu’il dit et pense, c’est moi qui le pense et le lui fait dire, sur l’histoire autant que sur l’émotion esthétique ou sur le dévoilement de l’œuvre d’art. Mais il n’est pas nécessairement le plus proche de moi parmi les personnages de l’ensemble de mes livres. Dans ces derniers, tous les personnages qui s’individualisent, qui sortent du cercle étroit de la famille ou de la communauté, qui partent à la rencontre du monde, ou qui ont des rêveries d’actions épiques sont des projections idéales de moi.
Votre narrateur est persuadé que l’histoire se déroule de manière totalement chaotique et qu’elle est souvent le fruit du hasard et des imprévus. Tout son propos va dans le sens de la réfutation des fameuses théories du complot – celle des interventions sous-jacentes des grandes puissances dans tous les événements de la planète – particulièrement prisées par les populations du monde arabe. Où vous situez-vous dans cette façon de penser le monde ?
L’homme n’aime pas le non-sens, ni le fait que l’histoire soit complètement erratique. Il faut que les événements soient lisibles, qu’il y ait un responsable, quelqu’un qui pilote le monde, qui sait où on va et qui nous y conduit. C’est la fonction que l’on attribue traditionnellement à Dieu, et qu’on attribue aujourd’hui, souvent, aux grandes puissances, à l’Amérique, à la Russie ou à la Chine. On peut aussi l’attribuer aux grands mouvements de société, aux forces économiques. Ou alors, dans une perspective paranoïaque, à des complots universels. Or il me semble plutôt que l’histoire et les événements qui se produisent en permanence sont davantage le fruit de planifications ratées, de l’intervention du hasard, de l’imprévu, mais aussi le résultat de l’incompétence ou de l’imprévoyance des hommes qui nous gouvernent, de la bêtise de leurs conseillers et des experts qui les entourent. Si on la regarde avec un peu de recul, on s’aperçoit que l’histoire n’est dotée d’aucune intentionnalité. Ou s’il y a des intentions initiales dans le déclenchement de chaque événement, leur déroulement est très vite dévoyé à cause de décisions prises sur le tas, maladroitement ou par sottise, ou à cause de mille hasards et tout va alors au gré de ce qui advient, que l’homme gère ensuite au mieux – ou le plus souvent au pire.
« Comme de l’art nous avons besoin de l’histoire pour ne pas mourir de la vérité, à savoir que tout n’est que chaos sans signification, sans logique et sans but », faites-vous dire à votre narrateur. Pouvez-vous nous développer un peu plus cette assertion ?
J’ai repris ici une phrase de Nietzsche qui parle de l’art. Ce que j’ai voulu dire en transposant cela au discours historique, c’est que tout ce que l’homme tente pour agir sur les événements et sur la marche de l’histoire est sans cesse perturbé par des hasards et des imprévus, par l’imprévoyance, l’incompétence ou les ambitions démesurées, ou simplement par la bêtise. Tout cela fait aller les choses ailleurs que là où on veut qu’elles aillent. Ce que les hommes font, du coup, apparaît comme un permanent jeu avec ces imprévus, une accommodation par rapport à l’avancée erratique des événements. Les hommes n’ont qu’une maîtrise très approximative des faits qu’ils sont appelés à gérer. Or ce grand récit que l’on appelle l’histoire gomme toutes ces approximations, effacent les aspérités, les incohérences, les possibles qui n’ont pas eu lieu alors qu’ils auraient été meilleurs que ce qui s’est produit, donnent cette impression que le monde a toujours été là où il devait aller et que les hommes qui ont gouverné durant des millénaires l’ont fait avec maîtrise et clairvoyance. En mettant de l’ordre après coup dans son chaos, en la reconstruisant, si l’on peut dire, les historiens nous rendent l’histoire lisible et raisonnable. Ils nous rendent du coup aussi le présent supportable. Parce qu’il est en effet difficile de vivre dans l’idée que tout est non-sens ou désordre et que le destin commun des humains est finalement dénué de raison et de cohérence.
« Dernière oasis » de Charif Majdalani (Actes Sud-L’Orient des livres, 270 pages). Disponible à la Librairie Antoine au prix de 280 000 LL.